Par Jean Wesley Pierre
Londres, 2 mai 2025
À partir du 1er juin, les femmes transgenres ne pourront plus participer aux compétitions de football féminin sous l’égide de la Fédération anglaise de football (FA). Cette décision, désormais officielle, s’appuie sur un arrêt récent de la Cour suprême britannique affirmant que la définition légale d’une femme repose sur le sexe biologique à la naissance. Une décision saluée par certains, décriée par d’autres. Un tournant décisif s’impose dans le débat complexe entre inclusion, équité sportive et droits humains.
La FA affirme que cette mesure vise à « préserver l’intégrité physique et l’équité de la compétition ». « Le football est un sport de contact. Il faut reconnaître que les différences biologiques ont un impact réel sur la sécurité et la performance », déclare un porte-parole de l’organisation. En clair, l’institution entend créer un cadre où la compétition se déroule entre athlètes partageant les mêmes caractéristiques biologiques de naissance.
Pour de nombreuses associations de défense des droits LGBT+, cette décision représente une exclusion injustifiée et stigmatisante. « On nie ici l’identité de milliers de femmes trans qui se battent chaque jour pour être reconnues et respectées », déplore Cara Jennings, militante trans et cofondatrice du collectif EqualPlay. Selon elle, les critères biologiques imposés sont une régression. « La transition hormonale réduit considérablement la masse musculaire et les performances. Ces femmes ne disposent pas d’un avantage indu, et leur exclusion ne fait qu’amplifier leur marginalisation. »
Mais d’autres voix, y compris au sein des mouvements féministes et progressistes, commencent à se faire entendre. « Il ne s’agit pas de haine, ni de transphobie, mais de justice pour les femmes biologiques, trop souvent éclipsées dans les débats actuels », défend Claire Morvan, biologiste et militante pour l’équité sportive. Elle rappelle que « la physiologie masculine, même après une transition hormonale, peut conserver des caractéristiques avantageuses dans le sport de haut niveau ».
Cette position est également partagée par certaines militantes anticonformistes de gauche, comme l’essayiste britannique Sarah Cullen, qui estime que « l’idéologie de l’inclusion absolue a fini par court-circuiter la réalité matérielle du corps féminin ». Elle va plus loin : « Lutter pour les droits humains, c’est aussi lutter pour que les femmes biologiques aient des espaces protégés. L’égalité, ce n’est pas l’effacement. »
Certains proposent des alternatives. La création de catégories ouvertes, le développement de compétitions inclusives ou encore l’étude plus fine des niveaux hormonaux plutôt que du sexe biologique brut. Mais ces propositions peinent encore à convaincre les grandes fédérations sportives.
Ce débat révèle un fossé de plus en plus visible entre les principes d’inclusion identitaire et ceux d’équité biologique. Les partisans de l’interdiction se défendent de toute haine. Les militants trans y voient un recul des droits humains. Le sport devient ainsi un champ de bataille idéologique.
Une chose est certaine : derrière les crampons et les filets, c’est toute une société qui s’interroge sur les frontières entre identité, science et justice.



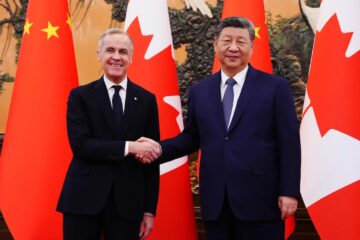

0 commentaire