Par la rédaction de Lawouze Info
10 Octobre 2025 — Le monde occidental la salue comme une héroïne de la démocratie. Le comité Nobel d’Oslo vient d’attribuer, ce vendredi, le prix Nobel de la paix 2025 à Maria Corina Machado, cheffe de l’opposition vénézuélienne à Nicolás Maduro.
Mais derrière le discours officiel, cette distinction cache une autre réalité : celle d’un prix éminemment politique, inscrit dans la guerre économique, médiatique et idéologique que les États-Unis et leurs alliés mènent depuis plus de vingt ans contre le Venezuela bolivarien.
Une “libératrice” soutenue par l’oppresseur
Maria Corina Machado, 58 ans, a été célébrée à Oslo comme « la libératrice » d’un pays en proie à la dictature. C’est ainsi que la décrit le comité Nobel, saluant son “courage civique” et son combat pour des “élections libres”.
Mais cette image lisse et émotive masque des contradictions profondes. Machado, issue des élites économiques de Caracas, n’a jamais été une femme du peuple, encore moins une figure de justice sociale. Ses prises de position pro-américaines, son soutien explicite à Donald Trump et sa proximité avec les intérêts pétroliers étrangers font d’elle non pas une icône de liberté, mais un instrument politique dans une stratégie d’asphyxie économique du Venezuela.
Dans un message publié sur X, la lauréate a même déclaré :
« Nous comptons sur le président Trump pour conquérir la liberté. Le Venezuela sera libre ! »
Libre, mais libre de quoi ? Libre de son pétrole, de sa souveraineté, de ses institutions populaires héritées du chavisme ? Libre d’un modèle qui, malgré ses erreurs, avait tenté de redistribuer les richesses à des millions de familles pauvres avant que les sanctions américaines ne plongent le pays dans le chaos ?
Les sanctions : une guerre économique silencieuse
Depuis 2015, les États-Unis ont imposé plus de 900 sanctions économiques au Venezuela, paralysant son industrie pétrolière, bloquant ses avoirs à l’étranger et coupant l’accès à ses ressources financières. Ces mesures, condamnées par l’ONU, ont provoqué l’effondrement de la monnaie, la pénurie de médicaments, et la pauvreté de masse.
Les chiffres sont accablants : plus de 70 % des Vénézuéliens vivent sous le seuil de pauvreté, et près de 8 millions ont dû fuir le pays.
Ces souffrances ne sont pas le fruit d’une “dictature” abstraite, mais bien d’un siège économique organisé.
En cela, la récompense donnée à Machado apparaît moins comme un hommage à la paix que comme une légitimation de la guerre économique menée contre un peuple qui tente de résister à l’emprise des grandes puissances.
Une guerre commencée avec Chavez
Ce conflit ne date pas d’hier. Il trouve ses racines dans le chavisme, ce mouvement né de la révolution bolivarienne initiée par Hugo Chávez, élu démocratiquement en 1998.
Chávez avait osé un sacrilège : nationaliser le pétrole, redistribuer les revenus vers l’éducation, la santé et les programmes sociaux, et affirmer que l’Amérique latine devait appartenir à ceux qui y vivent, non à ceux qui l’exploitent.
C’est à partir de ce moment que Washington a fait du Venezuela un ennemi à abattre.
La tentative de coup d’État de 2002, soutenue par les États-Unis, puis les vagues successives de sanctions et de déstabilisation économique, ont marqué le début d’une guerre silencieuse, où les mots “liberté” et “démocratie” sont devenus des armes idéologiques.
Machado s’inscrit dans cette continuité : celle d’une opposition qui ne parle pas pour les pauvres, mais pour les puissants.
Elle incarne le visage “acceptable” d’un projet de reconquête économique et géopolitique : celui de la reprise du contrôle des immenses réserves pétrolières du Venezuela, les plus importantes au monde.
Maduro, le diable utile
Nicolas Maduro, successeur de Chavez, est devenu le parfait bouc émissaire.
Son autoritarisme et ses erreurs économiques sont indéniables. Mais ils sont constamment utilisés comme alibi pour justifier l’ingérence étrangère, l’isolement diplomatique et les blocus économiques.
Washington, l’Union européenne et certains médias occidentaux ont imposé un récit unique : celui d’un peuple opprimé par un dictateur que seule une “libératrice” pro-américaine pourrait sauver.
Or, la réalité est plus complexe.
Ce peuple “qu’on prétend libérer” subit en silence les effets d’une politique étrangère qui l’écrase depuis dix ans : hôpitaux sans médicaments, salaires détruits, familles déchirées par l’exil.
Le Nobel : entre idéal et instrument politique
Le prix Nobel de la paix, censé récompenser la réconciliation et le dialogue, est aujourd’hui pris en otage par la géopolitique.
En distinguant Maria Corina Machado, le comité norvégien ne récompense pas un processus de paix, mais une stratégie d’affrontement.
C’est une manière subtile de dire au monde : “La démocratie vénézuélienne ne renaîtra que sous le drapeau occidental.”
Mais peut-on parler de paix quand un peuple entier est affamé par des sanctions ?
Peut-on parler de liberté quand la seule voie proposée est celle de la dépendance envers Washington ?
Un peuple qui continue de résister
Au-delà des discours, le peuple vénézuélien reste debout, malgré tout. Dans les quartiers populaires de Caracas, dans les campagnes d’Anzoátegui ou les écoles de Maracaibo, les gens continuent de s’entraider, de cultiver, de partager, de rêver d’un avenir où la souveraineté ne sera pas un slogan mais une réalité vécue.
Le Nobel de la paix aurait pu être un pont. Il est devenu un champ de bataille symbolique.
Et si Maria Corina Machado se dit “libératrice”, c’est peut-être parce que le mot “liberté” a perdu son sens dès qu’il a cessé d’être prononcé par le peuple lui-même.
“La paix ne se décrète pas à Oslo, elle se construit à Caracas.”
Et c’est là, au cœur des contradictions, que le véritable combat du Venezuela continue : celui d’un peuple qui refuse à la fois la dictature interne et l’oppression externe.



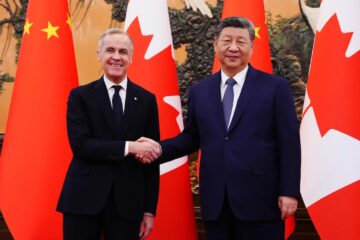

0 commentaire